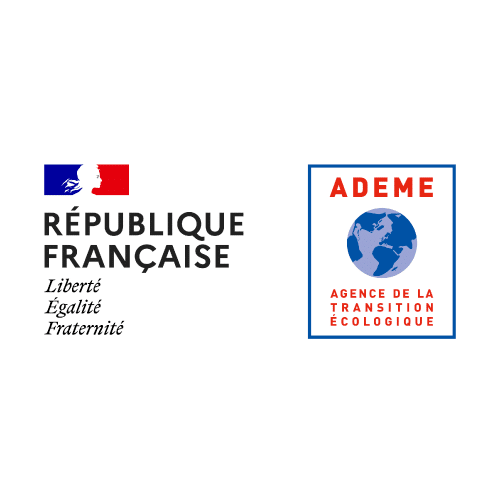







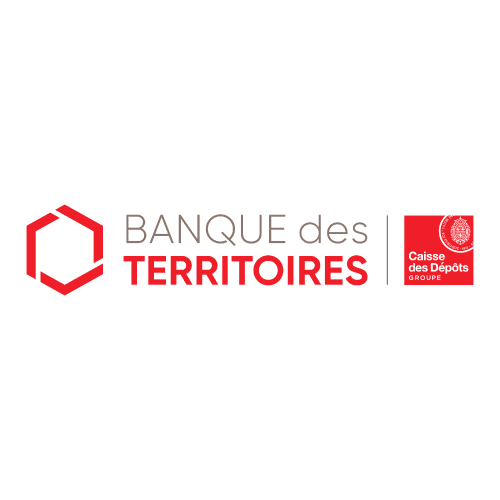
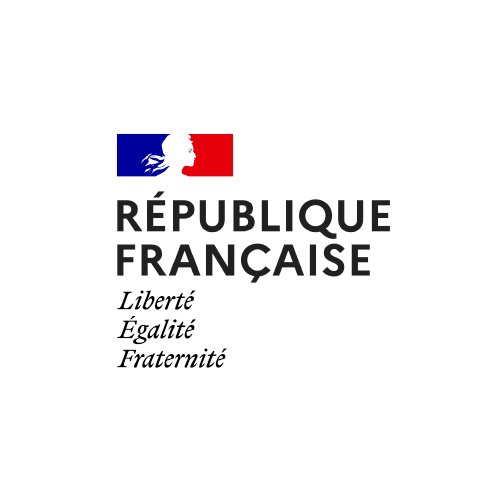
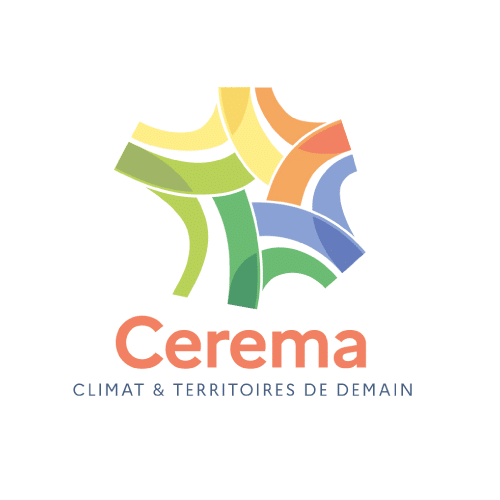


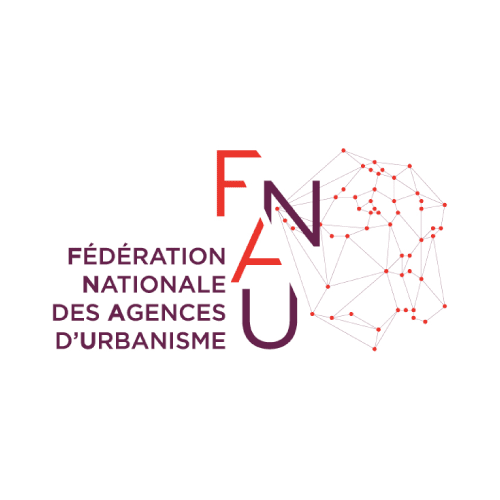

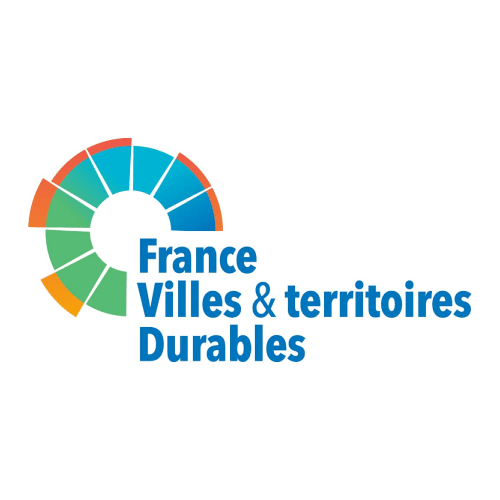










La biodiversité est le tissu vivant dans lequel s’exercent les activités du territoire. Elle joue un rôle essentiel pour la santé des habitants et l’ensemble des activités du territoire.
On distingue ce qui se passe sur le territoire (indicateurs 1 à 4) et l’impact des activités locales sur la biodiversité ailleurs (indicateur 5).
La biodiversité présente 3 caractéristiques principales : ce qui la compose, c’est-à-dire les espèces et habitats (1), sa structure, ou connexions entre zones de biodiversité (2), et ce qu’elle permet : fonctionnalités des écosystèmes, comme la pollinisation ou la régulation des maladies et ravageurs (3). Une 4ème analyse permet de lister les pressions exercées sur cette biodiversité locale par les activités du territoire : destruction d’habitats, pollutions, introduction d’espèces exotiques envahissantes… (4).
Parcs Naturels Régionaux, Office Français de la Biodiversité, Agences Régionales de Biodiversité, Conservatoires d’Espaces Naturels, Union Internationale pour la Conservation de la Nature, UICN, Inventaire National du Patrimoine Naturel, Evaluation Française des Ecosystèmes et des Services Ecosystémiques, France Nature Environnement, Ligue pour la Protection des Oiseaux, Fondation pour la Nature et l’Homme, Agences de l’eau, Museum locaux d’histoires naturelles, Chambres d’agriculture, Agences Régionales de l’Energie en lien avec le Réseau des ARE… entreprises et bureaux d’études spécialisés.
Calcul de l’état de fonctionnement des écosystèmes d’un territoire à partir de cartographies de couverture des sols. Un document méthodologique écrit dans le cadre d’un partenariat entre les MINES Saint-Etienne et France Villes et territoires Durables peut être partagée.
Contacter [email protected] ou [email protected] pour y avoir accès.
Chaque analyse proposée peut faire l’objet d’une cible permettant d’établir le niveau à partir duquel la situation du territoire est estimée durable du point de vue de la biodiversité. Deux types d’analyses sont ici particulièrement pertinentes :
-Soit en se centrant sur la diversité des populations d’oiseaux dont les variations donnent un indice sur l’ensemble de la biodiversité du territoire. C’est par exemple ce qui a été fait pour le Donut de Grenoble (pourcentage d’espèce menacées – page 41) ou du Pays de Galles (santé des population relativement à 1970 page 53).
Soit en se centrant sur l’ensemble des espèces à travers les listes rouges de l’IUCN. Voir par exemple le Donut du Grand Genève (maximum 1% d’espèces menacées et éteintes localement – page 29)
Un document méthodologique écrit dans le cadre d’un partenariat entre les MINES Saint-Etienne et France Villes et territoires Durables peut être partagé pour faciliter cette analyse des indicateurs notamment à l’aide de l’établissement de cibles, contacter [email protected] ou [email protected] pour y avoir accès.
Limiter les émissions de gaz à effet de serre (dioxyde de carbone, méthane, protoxyde d’azote) de votre territoire et leur impact sur le climat est essentiel pour lutter contre le dérèglement climatique et respecter les accords de Paris (maintenir l’augmentation des températures à + 2°C).
Pour évaluer la contribution d’un territoire au réchauffement climatique, il est possible de mesurer à la fois les émissions locales en gaz à effet de serre (indicateur 6) et le bilan carbone importé du territoire (9). Dans une perspective de planification, une analyse du système énergétique est aussi proposée car la consommation d’énergie est le principal vecteur d’émissions de gaz à effet de serre et un levier parmi les compétences des territoires : politiques de mobilité, d’habitat, de production énergie… (8).
GIEC et GREC locaux, ADEME et Agences Régionales de l’Energie en lien avec le RARE, COP locales, CSTB, Guichets locaux de l’ingénierie (ingenierie@département.gouv.fr, mettre le département concerné), entreprises et bureaux d’études spécialisés.
L’établissement d’une cible sur les émissions de gaz à effet de serre d’un territoire permet de guider les arbitrages. La Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) est une bonne référence. Elle vise en 2050 la neutralité sur les émissions locales de gaz à effets de serre (6) et une réduction de l’empreinte carbone (9).
Pour intégrer l’objectif de neutralité à 2050 dans une représentation Donut ou limites planétaires, il est possible de calculer le budget à disposition d’un territoire en partant des budgets d’émissions à disposition avant d’atteindre +1.5°C ou +2°C partagés par le GIEC (tableau RID.2 page 33). Plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour transformer ces budgets en cibles annuelles pour les territoires. Elles sont par exemple bien expliquées dans l’analyse limites planétaires sur la métropole de Lyon (publication d’ici fin mars) ou sur la France (rapport CGDD – page 27).
Un document méthodologique écrit dans le cadre d’un partenariat entre les MINES Saint-Etienne et France Villes et territoires Durables peut être partagé pour faciliter cette analyse des indicateurs notamment à l’aide de l’établissement de cibles, contacter [email protected] ou [email protected] pour y avoir accès.
L’usage des sols présente un impact environnemental important : sur la biodiversité (analysé en 3 et 4), le climat (émissions de la construction, changement du stockage carbone des sols) et le cycle de l’eau (ruissellement).
Le plus pratique pour les territoires est de se référer à la loi ZAN (indicateurs 10 et 11). Dans une perspective de planification, une analyse prospective est proposée pour permettre de mettre en place une trajectoire de sobriété foncière (indicateur 12).
ADEME (pôle aménagement des villes et territoires), Cerema, EPF, Agences d’Urbanisme, Agences locales de la Banque des Territoires, PNR, Agences Régionales de l’Energie, CAUE, réseau Planif’Territoires, guichets locaux de l’ingénierie, observatoires locaux de l’occupation des sols, entreprises et bureaux d’études spécialisés.
L’utilisation des cibles légales en termes de consommation d’espaces naturels et forestiers (ENAF, indicateur 11) sur 2021-2030 et d’artificialisation nette à horizon 2050 (indicateur 10) sont une bonne manière de préparer les arbitrages.
S’intéresser au cycle de l’eau implique les rivières, les plans et nappes d’eau, ainsi que l’eau contenue dans les plantes et les sols. Ce cycle influe sur la qualité et la quantité d’eau douce pour les activités locales et le fonctionnement de la biodiversité. Il concerne bien sûr les précipitations et le risque de ruissellement.
Pour connaitre la disponibilité en eau douce, des analyses sont proposées pour le niveau des nappes (indicateur 13) et des débits cours d’eau (16). Les indicateurs 14 (prélèvements) et 15 (réutilisation des eaux usées) permettent de suivre les pressions sur cette ressource.
Des analyses sont aussi disponibles pour le suivi du taux d’humidité des sols (17).
Enfin, comme la biodiversité ou le climat, des méthodes sont en cours de développement pour analyser l’impact de la consommation d’un territoire sur la ressource en eau hors territoire (18).
Les documents de planification (SDAGE, SAGE, PGRE, contrats de rivière ou de bassin) encadrent l’utilisation et la gestion des ressources en eau douce, en s’appuyant sur les données précises du cycle de l’eau (prélèvements, usages, qualité), on y trouve un certain nombre de données locales.
De nombreuses structures locales travaillent sur l’état des eaux, en premier lieu l’Agence de l’eau, les observatoires locaux, SIAEP, Comités Locaux de l’Eau, EPAGE, EPTB, Comités de rivière ou bassins, ainsi que les gestionnaires locaux, Guichets locaux de l’ingénierie (ingenierie@département.gouv.fr mettre le département concerné), entreprises et bureaux d’études spécialisés.
Chaque analyse proposée peut faire l’objet d’une cible permettant d’établir le niveau à partir duquel la situation du territoire est jugée durable concernant le cycle de l’eau. Dans les synthèses Donut et Limites Planétaires existantes, on privilégie les cibles suivantes :
Un document méthodologique écrit dans le cadre d’un partenariat entre les MINES Saint-Etienne et France Villes et territoires Durables peut être partagé pour faciliter cette analyse des indicateurs notamment à l’aide de l’établissement de cibles, contacter [email protected] ou [email protected] pour y avoir accès.
Cette catégorie rassemble toutes les pollutions émises par les activités humaines qui peuvent avoir un impact négatif sur la biodiversité ou sur les habitants.
Les indicateurs s’intéressent aux pollutions des eaux (19), de l’air (20) et des sols (21).
Chambres d’agriculture ou DRAAF, Agence de l’Eau, SIAP, Comités Locaux de l’Eau, EPAGE, EPTB, observatoires locaux Santé, ARS, ORS, GREC ou GIEC locaux, antennes locales du Cerema, entreprises et bureaux d’études spécialisés.
Un document méthodologique écrit dans le cadre d’un partenariat entre les MINES Saint-Etienne et France Villes et territoires Durables peut être partagé pour faciliter cette analyse des indicateurs notamment à l’aide de l’établissement de cibles, contacter [email protected] ou [email protected] pour y avoir accès.