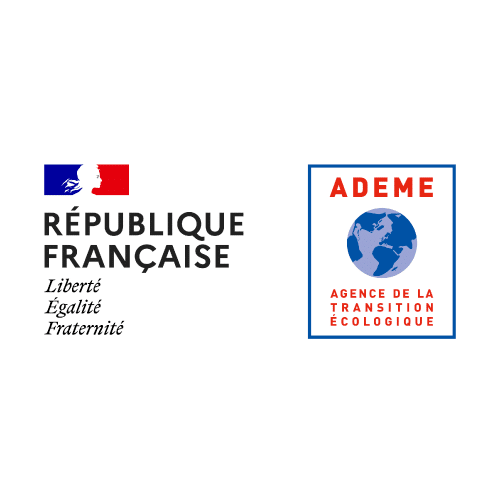







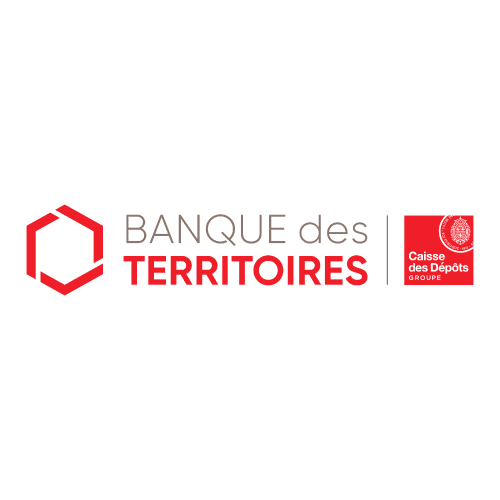
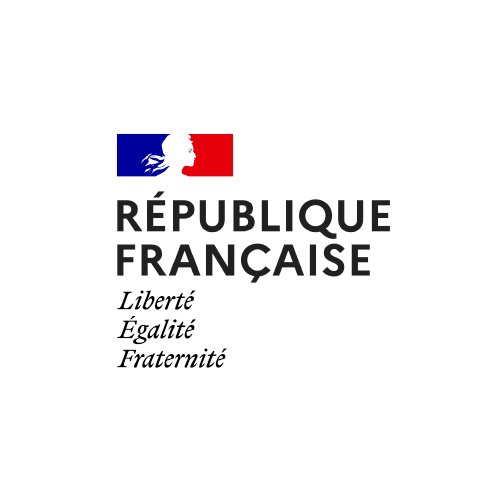
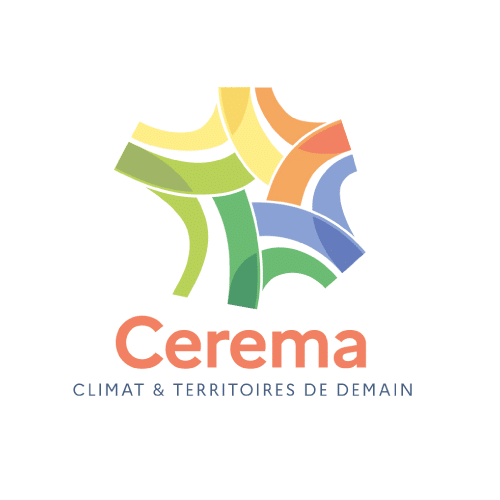


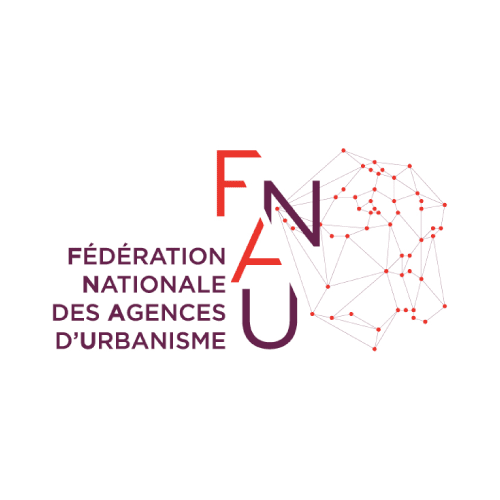

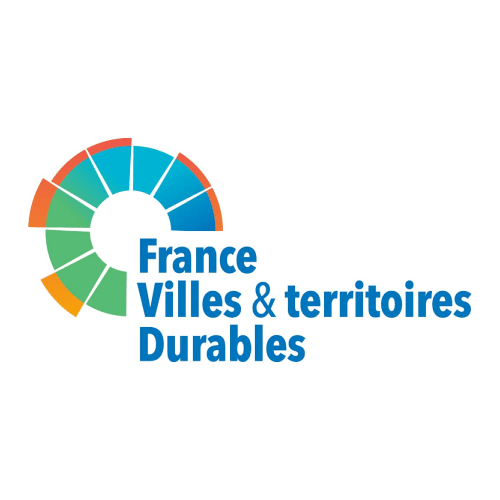










CAP Territoires durables vise à fournir à l’ensemble des collectivités françaises, pour le mandat 2026 – 2032, une aide à l’orientation et à la priorisation des projets, fondée sur une vision plus complète des nouveaux enjeux locaux.
A l’échelle de votre collectivité, cette initiative partenariale permet de :
par l’accès à des ressources et outils permettant de valoriser et mettre à jour vos diagnostics existants, et ainsi mieux connaître vos nouveaux enjeux locaux (environnementaux, socio-économiques, adaptation et gestion des risques, ressources matérielles et immatérielles).
ans un contexte budgétaire qui impose de prioriser et mieux arbitrer entre les projets (vote du budget, Plan Pluriannuel d’Investissements – PPI), ainsi que de planifier sur votre territoire les politiques nationales de transition écologique.
autour d’une vision commune et objectivée des enjeux socio-écologiques, et de décisions mieux partagées et soutenues.
CAP Territoires Durables est totalement flexible et adaptable aux spécificités de votre territoire. Nous recommandons 2 étapes bien lancer votre prochain mandat, mais celles-ci peuvent être menées séparément.
Installez autour de votre direction des services une ambition transverse, en interne et avec les parties prenantes du territoire.
Collectez les informations et complétez votre diagnostic local
Votre collectivité détient déjà un grand nombre d’informations utiles dans vos différents diagnostics (SCoT, PLUi-H, PCAET, CRTE…). Après les avoir rassemblées, vous pouvez les répertorier dans les 4 panoramas de cette grille, et vous appuyez sur les panoramas de CAP Territoires Durables pour compléter les éventuelles données manquantes. Le cas échéant, vous pouvez compléter en ayant recours à l’ingénierie publique ou privée, en particulier sur les aspects prospectifs.
Associer les parties prenantes locales (habitants, associations, observatoires, experts, entreprises…) à la collecte des informations permet de bénéficier d’une analyse plus complète et de fédérer les acteurs dès cette phase de recensement des besoins.
Synthétisez votre diagnostic et dessinez le portrait de votre territoire
Disposer d’une quantité importante de données n’est pas une fin en soi. L’enjeu réside plutôt dans l’analyse que l’on peut en tirer pour nourrir votre projet de territoire, dégager des priorités, signaler d’éventuelles vulnérabilités et identifier vos atouts. La finalité du diagnostic est d’éclairer la prise de décision. CAP Territoires Durables vous y aide :
Partagez cette représentation auprès des élus, services et acteurs locaux pour une appropriation commune des enjeux de votre territoire.
Le diagnostic n’est pas figé. Il est dynamique par définition : non seulement certaines données doivent être mises à jour pour être pertinentes, mais les tendances qu’elles dessinent sont parfois plus riches d’enseignements que leur seule valeur absolue. Ces tendances sont autant d’indications sur les dynamiques territoriales et les priorités d’action à en déduire.
Utilisez la grille d’aide à la décision pour chacun de vos projets et vérifier ainsi qu’aucun enjeu majeur n’a été oublié dans son élaboration. C’est un atout supplémentaire offert aux élus pour objectiver et renforcer la prise de décision.
Cette grille peut être utilisée pour chaque décision importante : orientation de vos projets, hiérarchisation de votre PPI, écriture de vos plans d’urbanisme, contribution aux démarches de planification écologique impulsées par l’Etat…
Téléchargez la fiche tutoriel CAP Territoires Durables pour vous guider pas à pas : confortez votre diagnostic puis utilisez la grille d’aide à la décision.
CAP Territoires Durables s’adresse à toutes les collectivités françaises : EPCI et communes, en milieu rural, urbain, périurbain, littoral… Chaque collectivité peut personnaliser les supports de CAP Territoires Durables en fonction de ses spécificités et priorités politiques, tout en s’appuyant sur un socle commun de réflexion et d’action.
Il est par exemple possible de pondérer les différentes questions de l’aide à la décision, pour souligner le caractère plus important de tel ou tel aspect, en fonction des priorités issues du diagnostic.

Le panorama de diagnostic et l’aide à la décision de CAP Territoires Durables s’appuient sur un socle robuste de publications scientifiques, en particulier les éléments du panorama environnemental (limites planétaires, Rockström et al, 2009) et du panorama socio-économique (économie du Donut, Raworth, 2017).
CAP Territoires Durables a été co-construit avec les membres du comité scientifique commun entre France Villes et territoires Durables et les Ecoquartiers du Ministère de la transition écologique, et avec l’appui de l’Ecole des Mines de Saint-Étienne.
La plateforme a bénéficié des apports des nombreuses institutions nationales partenaires, ainsi que de la relecture exigeante de l’ensemble de l’écosystème de l’association France Villes et territoires Durables : membres et partenaires experts, publics et privés.
CAP Territoires Durables est coordonné avec les porteurs de la planification écologique à l’échelle nationale : ANCT, CGDD, SGPE. Elle est une contribution à la territorialisation de la planification écologique.
Les 4 panoramas proposent une liste d’éléments à considérer pour obtenir un diagnostic complet. Il s’agit d’un canevas auquel la collectivité peut se référer pour renforcer son diagnostic existant. Chacun des panoramas contient les informations suivantes :
Une page présente ensuite plusieurs manières de synthétiser ces résultats et de les représenter graphiquement pour en faciliter la lecture et l’appropriation.
L’aide à la décision offre une grille de questions sur les impacts potentiels des projets, afin de vérifier que tout projet est résilient, effectivement adapté aux enjeux socio-environnementaux et pour toiletter les Programmations Pluriannuelles d’Investissements (PPI) au début du mandat 2026-2032.
La grille est totalement adaptable par la collectivité à ses réalités et enjeux locaux. Elle est modulable, il est possible d’ajouter ou supprimer des items, et de leur attribuer une pondération traduisant les priorités issues du diagnostic local et des orientations politiques.
Conseil d’emploi : débattre en interne de la liste de questions puis, une fois stabilisée, s’en servir d’outil supplémentaire à disposition des arbitrages politiques.
Le diagnostic territorial n’est pas une fin en soi, mais un levier stratégique pour adapter les politiques publiques et les projets aux nouveaux enjeux locaux.
Pour assurer cette cohérence, les panoramas de diagnostic et l’aide à la décision reposent sur une même architecture. Lors de la priorisation des projets, un système de couleur peut par exemple indiquer où en est votre territoire sur chaque enjeu et s’il constitue une priorité locale ou non. Par exemple, dans une zone exposée au risque d’inondation, cette problématique devrait impérativement nourrir la conception de l’ensemble des projets. De même, dans un territoire confronté au vieillissement de la population, il apparait crucial de comparer les impacts attendus des projets avec la situation démographique projetée.
Le diagnostic territorial ne peut se limiter à une photographie statique d’un instant donné. Les territoires sont en perpétuelle évolution, façonnés par une multitude de facteurs et d’acteurs.
Réaliser un état des lieux systémique et évolutif offre la possibilité de saisir les dynamiques territoriales dans leur ensemble et leur complexité mais également de détecter les tendances émergentes, d’anticiper les défis à venir et de concevoir des stratégies adaptées au long terme.