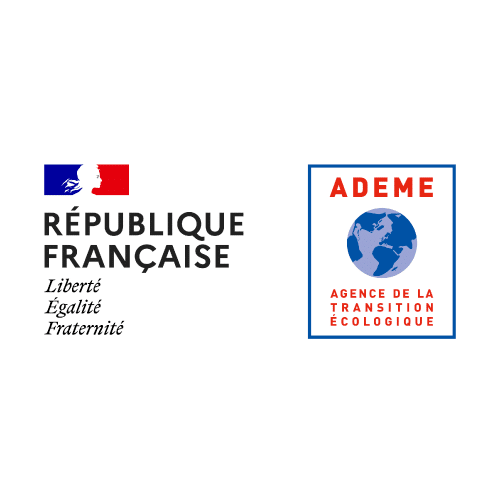







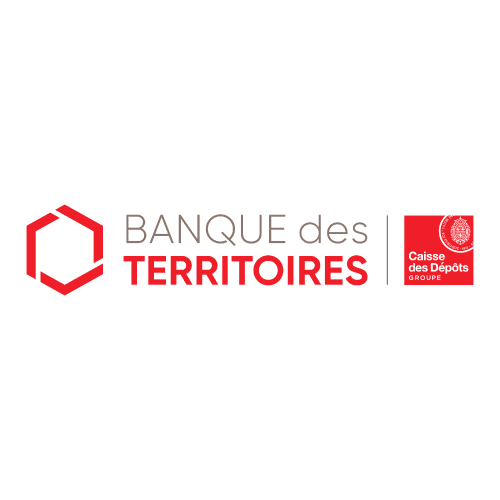
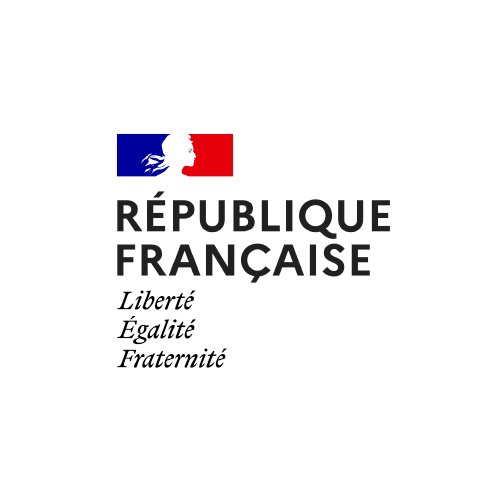
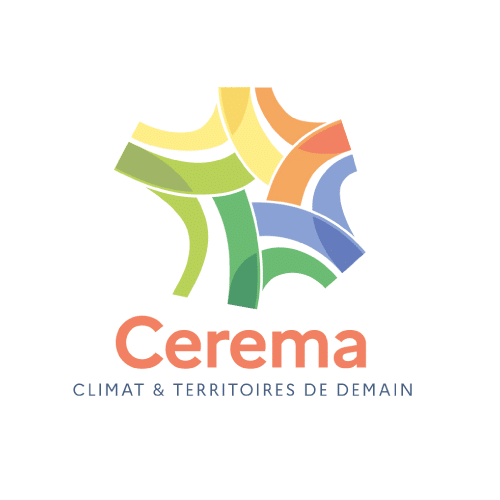


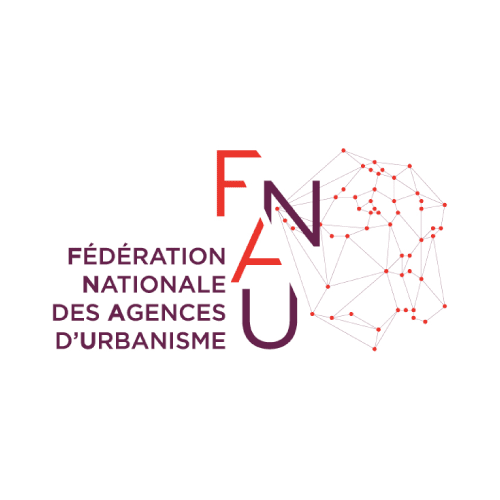

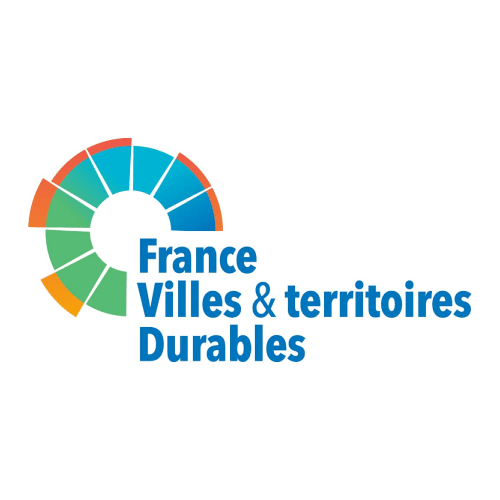










CAP Territoires Durables rassemble un grand nombre de partenaires engagés pour la transformation écologique et économique des territoires.
Totalement gratuit, il offre un panorama à 360° des sources de données disponibles pour mieux prendre en compte les enjeux locaux dans l’orientation des projets, les arbitrages budgétaires, les plans d’urbanisme… tout en s’inscrivant dans les trajectoires et politiques réglementaires nationales.
Connaître les données écologiques locales les plus à jour est en effet dorénavant incontournable pour Arbitrer en faveur de projets durables et Planifier la transition des territoires. Ce nouveau CAP pour des Territoires Durables conditionne la pérennité des investissements dans un contexte budgétaire contraint.
Dans cette perspective, les partenaires publics et privés conjuguent leurs approches et leurs ressources pour vous offrir ici une vision transverse et la plus complète possible des enjeux locaux.
CAP Territoires Durables s’articule autour de 2 étapes :
Afin de conduire ces 2 étapes, vous trouverez dans ce site 2 parties distinctes :
1. Un panorama des enjeux locaux: environnementaux, socio-économiques, d’adaptation face aux nouveaux risques (notamment liés au dérèglement climatique), et les ressources mobilisables pour les transitions. Ce panorama complet vous aide à renforcer votre vision actuelle et prospective des enjeux de votre territoire. En face de chaque enjeu, vous trouverez des propositions d’indicateurs locaux. Pour renseigner ces indicateurs, vous trouverez une liste des documents probablement déjà existants dans votre collectivité, une liste d’interlocuteurs à mobiliser, et des sources à explorer pour trouver l’information ! Cette liste d’indicateurs n’est ni exhaustive ni exclusive : elle peut être complétée ou modifiée en fonction des singularités et priorités de chaque territoire. Par ailleurs, CAP Territoires Durables n’a pas vocation à fournir un diagnostic déjà réalisé. Il offre en revanche le canevas pour réaliser un diagnostic plus complet. Certains aspects nécessitent une faculté à manier la data ou les cartes. Cela implique le recours à votre ingénierie interne, ou à défaut à l’ingénierie locale publique ou privée, par exemple les agences d’urbanisme, le CEREMA, les bureaux d’études…
2. Un guide d’aide à la décision: Au moment d’orienter ou faire bifurquer vos projets, à l’occasion de l’élaboration ou de la révision des Programmations Pluriannuelles d’Investissements (PPI), lors de la rédaction des documents d’urbanisme (PADD, PLUi, SCoT…), ou encore pour contribuer dans les territoires à la planification écologique impulsée par les programmes de l’Etat (COP régionales, CRTE, Budgets verts…), vous disposez avec CAP Territoires Durables d’un guide d’aide à la décision, sous la forme d’une liste de questionnements essentiels, pour vérifier la résilience des projets et la pérennité des investissements.
Cette aide à la décision tient compte à la fois des besoins socio-économiques des parties prenantes locales, habitants, institutions, entreprises… (panorama socio-économique), des paramètres qui conditionnent l’habitabilité des territoires à l’avenir (panorama environnemental : biodiversité, climat, usage des sols, cycle de l’eau, pollutions), des vulnérabilités et risques à considérer pour l’adaptation au dérèglement climatique (panorama risques et adaptation), ainsi que des ressources à préserver ou à mobiliser pour les transitions (panorama ressources)…
Il invite ainsi les collectivités à vérifier l’ensemble des paramètres qui déterminent la pertinence d’un projet face à des bouleversements d’une ampleur inédite.
CAP Territoires durables est largement co-construite et bénéficie d’une amélioration constante grâce à la mobilisation :
CAP Territoires Durables se réfère au cadre scientifique des limites planétaires, aujourd’hui envisagé à toutes les échelles (initié par l’Agence de l’Environnement suédoise en 2013, testé par l’Union Européenne (Agence Européenne de l’Energie, 2021), la France (Commissariat Général au Développement Durable, 2023) et les territoires (le SCoT Sud-Loire en 2021, Métropole de Lyon en 2025).